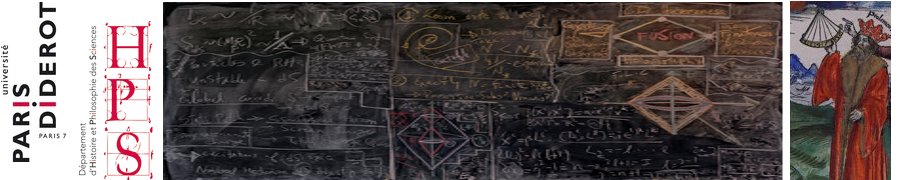Médecine
Objectifs :
- Inscrire les savoirs et pratiques de la médecine dans l’histoire sociale, l’histoire des idées et l’histoire des sciences
- Comprendre l’évolution des conceptions de la santé et de la maladie et du statut du patient jusqu’à la période contemporaine
- Initier aux corpus, concepts et méthodes propres aux SHS.
2- le Module « Ethique et Epistémologie » de l'
UE 7 "Santé, société, humanité" du L3 Santé
Objectifs :
- Approfondir l’apprentissage des principes et valeurs de l’éthique ;
- Identifier et analyser les problèmes éthiques posés par un cas ou une situation clinique ;
- En saisir les enjeux philosophiques ;
- Les contextualiser grâce à l’histoire, l’épistémologie et les sciences sociales (sociologie, anthropologie)
3- le Certificat optionnel DCEM 1 : « Médecine et Cinéma : Perceptions de la maladie et du soin à partir de l’outil cinématographique »
Objectifs :
Ce certificat optionnel destiné aux étudiants de DCEM 1 est un enseignement d’histoire, de philosophie et d’éthique de la médecine qui utilise le support cinématographique en vue de sensibiliser au soin en médecine.
L’histoire du cinéma offre un très large éventail d’œuvres abordant les problèmes humains et sociaux de la médecine que l’histoire, la philosophie et l’éthique aident à formuler, clarifier et approfondir. Ces oeuvres et ces disciplines permettent en particulier d’interroger la notion et les pratiques de soin. Elles éclairent les valeurs du soin ; l’expérience du patient (l’expérience de la souffrance, de la maladie, de l’accident, du handicap, de la guérison, de la mort, le retentissement psychologique, familial et socioprofessionnel de la maladie) ; les moments cruciaux de la relation médecin/patient (la demande de soin, l’annonce de la maladie, l’information du patient, la décision médicale, le suivi de la maladie chronique, etc.) ; les expériences des soignants ; la formation médicale ; les limites du soin ; le soin en situation d’urgence ou de guerre ; les relations de la médecine et de la société (la fonction sociale de la médecine, l’accès aux soins et la justice sociale, la gestion sociale et médicale du risque sanitaire) ; le fonctionnement des institutions de santé.
Cette projection des étudiants de médecine dans la vie des patients et des soignants vise à questionner et à intégrer, de manière concrète, vivante et personnelle, l’expérience et les enjeux éthiques du soin. La narration et la fiction cinématographiques permettent aux étudiants de se décentrer du point de vue médical pour approcher et tenter de comprendre celui du sujet et du patient. Elles permettent de distinguer registre du traitement de la maladie et registre de la prise en charge du malade. Ce décentrement est facilité par l’image et l’incarnation des récits, des personnages et des situations, d’autant que les films sont choisis pour leurs qualités esthétiques, projetés dans leur intégralité et analysés au titre d’œuvres d’art et non réduites à des illustrations pédagogiques. Narration et fiction cinématographiques permettent, de manière fondamentale, de ne pas abstraire les problèmes éthiques de la vie des malades.
L’enseignement s’appuie sur la prise de parole des étudiants, leur travail personnel d’analyse et de réflexion sur les films et les textes fournis.
L’enseignement allie mobilisation des affects et de l’empathie, analyse rationnelle des enjeux moraux du soin et réflexion personnelle sur les situations cliniques. L’étude narrative se complète du recours à l’histoire, la philosophie et aux sciences sociales.
4- le Certificat optionnel DCEM 2 : « Médecine et Cinéma : Savoirs et pouvoirs en médecine »
Objectifs :
Ce certificat optionnel destiné aux étudiants de DCEM 2 est un enseignement d’histoire, de philosophie et d’éthique de la médecine qui utilise le support cinématographique en vue de comprendre comment se sont constitués, au cours de l'histoire, certains savoirs sur le corps et l'esprit humains et quels sont les usages, passés et actuels, que la médecine en fait.
On y montre que la constitution et les usages des savoirs médicaux sont liés au contexte social au sens large du terme, et en particulier aux normes et aux pouvoirs propres à ce contexte.
On souligne ainsi notamment que les savoirs et pouvoirs médicaux ne sont pas nécessairement liés à la maladie ni à une finalité thérapeutique, mais aussi à la conservation et à la promotion de la santé, de la salubrité, de l’hygiène, de la sécurité, du bien-être, de l’ordre social, etc. , réinvestissant et renouvelant à toutes les époques la distinction entre normal et pathologique.
L’approche historique et épistémologique dans ce CO a pour ultime finalité d’éclairer les questions sociales et éthiques que posent les situations cliniques et les pratiques médicales actuelles : savoirs et pouvoirs dans la relation thérapeutique ; essais cliniques ; pratiques liées à la procréation (AMP, dépistages et diagnostics préimplantatoires et anténatals, IMG, histoire de l’eugénisme) ; dépistage, prédiction, annonce de maladies génétiques graves ; prises en charge et politiques du handicap ; prises en charge et politiques psychiatriques ; santé publique et sexualité ; etc.
L’enseignement s’appuie sur la prise de parole des étudiants, leur travail personnel d’analyse des films et des articles et sur l’échange avec les enseignants de sciences humaines et sociales et les praticiens.
5. l'UE 13 : "De la construction biologique de la santé et de la maladie aux enjeux sociaux de la biomédecine" (UE appartenant à la fois au Master Biologie cellulaire, Physiologie, Physiopathologie) et au Master Histoire et Philosophie des Sciences (ex LOPHISS-SPH)).
Objectifs :
- Acquérir des connaissances fondamentales concernant l’histoire de la construction des maladies et des savoirs et pratiques de la biomédecine, des débuts de la médecine scientifique (19ème s.) aux pratiques les plus récentes ;
- Comprendre les débats épistémologiques contemporains sur la distinction santé/maladie ;
- Acquérir des connaissances fondamentales concernant l’évolution historique du statut du patient, des relations médicales et de l’expérience de la maladie ;
- S’initier à la recherche en sciences humaines et sociales en médecine : épistémologie ; histoire, philosophie, sociologie des sciences biomédicales ; anthropologie, sociologie et philosophie de la maladie.
6. Ces enseignements initient également les étudiants aux corpus, questions, problèmes, méthodes de la recherche en histoire, philosophie et éthique de la médecine. Ils leur permettent de s’engager, dans le cadre d'un double cursus, dans la recherche en SHS en santé, notamment dans le Parcours à dominante Médecine du Master LOPHISS-SPH (Université Paris Diderot) qui prépare à un doctorat pouvant porter sur l’histoire, la philosophie ou l’éthique des pratiques biomédicales. En M1, sont proposées, outre les enseignements généraux et méthodologiques en histoire et de philosophie des sciences, une UE pluridisciplinaire alliant histoire, philosophie, anthropologie et éthique de la médecine consacrée à la construction des maladies et à l’évolution du statut du patient (cette UE est mutualisée avec un master médical, ce qui permet de mêler étudiants d’histoire et de philosophie et étudiants de médecine) ainsi qu’une UE d’Epistémologie de la médecine consacrée au raisonnement médical. En M2, sont proposées deux UE consacrées à l’inscription de la médecine dans les rapports sciences/sociétés. L’une étudie la manière dont le vivant est devenu à partir du 18ème siècle un objet de représentation, d’intervention, d’appropriation et de mobilisation sociales : sont abordés les notions de race, les sciences épidémiologiques et l’exemple du sida. L’autre analyse la place des épidémies et des maladies dans l’histoire culturelle, sociale et politique. Une troisième UE est consacrée à l’éthique appliquée. Ces enseignements sont complétés par des UE d’histoire et philosophie des sciences de la vie. En M1 l’étudiant rédige un mini-mémoire, en M2 un mémoire de recherche.